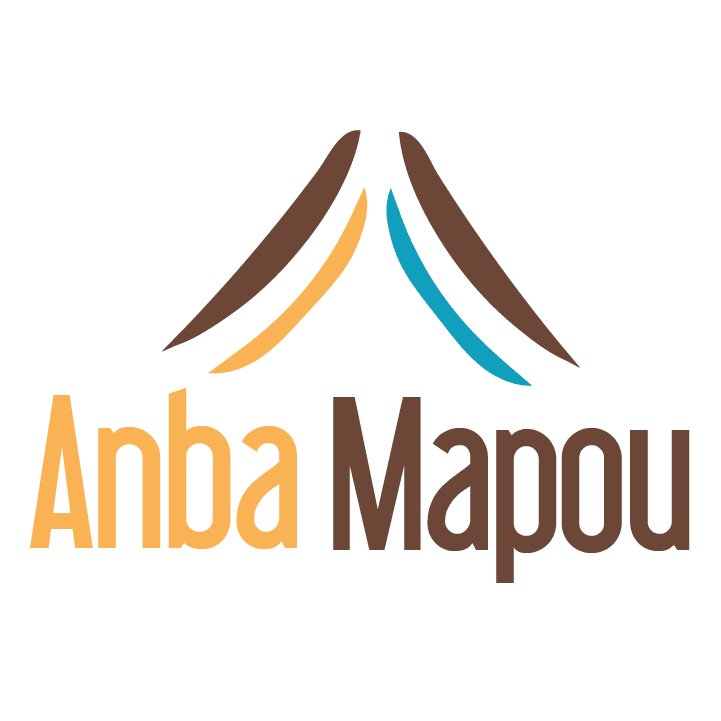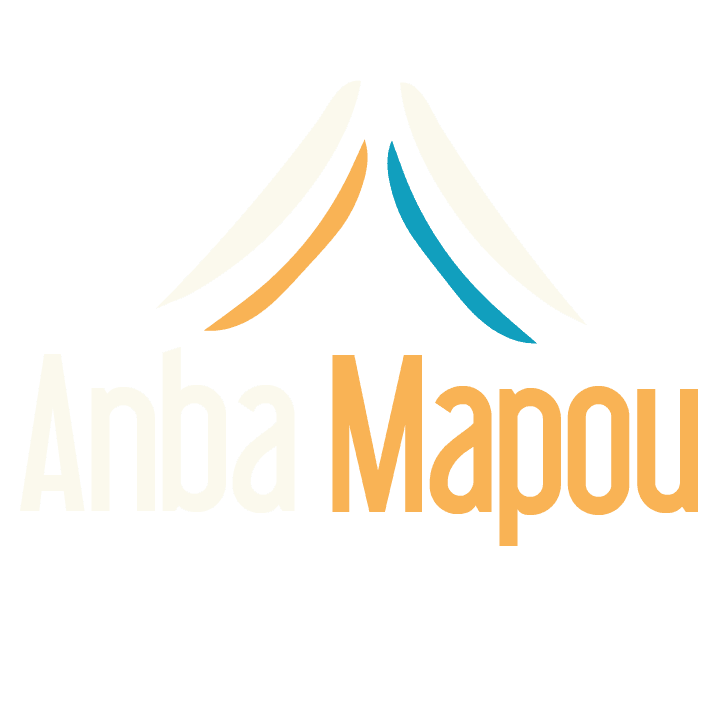Le 12 janvier 2010, un séisme d’une magnitude de 7.0 a frappé Haïti, causant des ravages sans précédent. Quinze ans plus tard, le pays reste marqué par cet événement tragique, tant par ses souvenirs douloureux que par les opportunités manquées de la reconstruction.
Parmi les acteurs de l’après-séisme, la Croix-Rouge américaine et d’autres ONG internationales, qui avaient promis de transformer la tragédie en une nouvelle ère de développement, sont au cœur de controverses concernant une gestion opaque des fonds destinés aux victimes.
Le tremblement de terre de 2010 a causé des pertes humaines et matérielles colossales :
- 230 000 morts, des milliers de blessés et plus de 1,5 million de déplacés.
- La destruction des infrastructures essentielles : hôpitaux, écoles, bâtiments gouvernementaux, routes et systèmes d’approvisionnement en eau.
Face à cette tragédie, la communauté internationale a répondu par une mobilisation sans précédent. Des milliards de dollars ont été collectés pour venir en aide à Haïti, mais l’enthousiasme initial a rapidement laissé place à des accusations de détournements et d’inefficacité.
Un échec en matière d’urbanisme et de résilience
La croissance incontrôlée de Port-au-Prince
La reconstruction devait servir de tremplin pour repenser l’urbanisme d’Haïti et réduire la vulnérabilité de Port-au-Prince aux catastrophes naturelles. Cependant, la réalité est bien différente.
Selon Antoine Rivière, géographe et spécialiste de l’urbanisme en Haïti, le développement de la capitale est resté chaotique. Entre 2010 et 2014, Port-au-Prince a connu une croissance anarchique de 18,3 km² par an, principalement dans des zones à risques.
Ce manque de planification expose la population à des catastrophes futures. Les terrains fragiles, occupés par des constructions précaires, aggravent les risques en cas de séisme ou d’inondations.
La Croix-Rouge américaine : des accusations de corruptions
Une collecte record, mais des résultats décevants
Après le séisme, la Croix-Rouge américaine a levé près de 500 millions de dollars pour la reconstruction en Haïti. Cette somme colossale devait servir à reconstruire des maisons, des écoles, des hôpitaux et à relancer l’économie.
Cependant, une enquête menée en 2015 par ProPublica et NPR a révélé des incohérences majeures :
- Seulement six maisons reconstruites avec ces fonds, alors que des dizaines de milliers étaient promises.
- Une grande partie des ressources aurait été absorbée par des frais administratifs et des consultants externes.
- L’absence de suivi et de transparence sur la manière dont les fonds ont été utilisés.
Un recours collectif, déposé en 2025 par une organisation de la diaspora haïtienne, réclame 1 milliard de dollars à la Croix-Rouge et à ses affiliés. Les plaignants dénoncent une gestion opaque des fonds, des frais administratifs excessifs et l’incapacité à réaliser des projets essentiels pour les victimes.
Une coordination chaotique dès le départ
La Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH)
La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH), créée après le séisme du 12 janvier 2010, a été critiquée pour sa gestion des fonds de reconstruction. Des rapports indiquent que des ONG, sous l’influence présumée de l’ancien président Bill Clinton, ont reçu des fonds sans les utiliser sur le terrain, accumulant entre 15 et 40 millions de dollars sans dépenses effectives selon RHINEWS. De plus, l’opacité des dépenses et le manque de transparence dans l’allocation des ressources ont alimenté les préoccupations concernant la corruption et l’inefficacité de la CIRH rapporte AyiboPost
La gestion de la reconstruction a été confiée à la CIRH, co-présidée par Bill Clinton et Jean-Max Bellerive. Si cette commission visait à coordonner les fonds internationaux et les projets de reconstruction, elle a rapidement été critiquée :
- Manque de coordination : Les nombreuses agences internationales et ONG travaillaient souvent de manière indépendante, sans une vision commune.
- Faiblesse des institutions locales : Déjà fragilisées avant le séisme, les administrations haïtiennes n’ont pas pu jouer un rôle central dans la planification des projets.
En 2011, le président Michel Martelly, un autre potentiel grand corrupteur, a dissous la CIRH, promettant de redonner le contrôle aux Haïtiens. Mais cette décision a marqué le début d’une série de détournements massifs, notamment via les fonds PetroCaribe.
PetroCaribe et la corruption institutionnalisée
Le programme PetroCaribe, initié en 2005 par le Venezuela, visait à fournir du pétrole à des conditions préférentielles à plusieurs pays des Caraïbes, dont Haïti. Les économies réalisées grâce à ce programme devaient financer des projets de développement et des initiatives sociales en Haïti. Cependant, des rapports et audits ultérieurs ont révélé une mauvaise gestion et une corruption généralisée dans l’utilisation de ces fonds. En 2017, une commission sénatoriale haïtienne a publié un rapport accusant des hauts fonctionnaires, dont deux anciens premiers ministres, d’avoir détourné près de 2 milliards de dollars des fonds PetroCaribe destinés à la reconstruction post-séisme. Des projets tels que le Village Lumane Casimir, censé fournir des logements aux victimes du séisme de 2010, illustrent cette corruption. Bien que 3 000 unités de logement aient été prévues pour un coût de 49 millions de dollars, moins de la moitié ont été construites, et beaucoup restent inachevées ou vacantes(NACLA).
En mai 2019, la Cour des comptes haïtienne a publié un rapport détaillant des irrégularités dans plus de 419 projets financés par PetroCaribe, mettant en évidence des pratiques telles que le blanchiment d’argent, l’enrichissement illicite, l’octroi illégal de contrats, la surfacturation et le népotisme. Par exemple, le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) a été critiqué pour une « dilapidation totale de l’argent », avec 80 000 bénéficiaires fictifs et des fonds exorbitants alloués à des activités non liées, comme les festivités du Carnaval (Réseau d’Investigations Caribéennes)
Les fonds PetroCaribe, fournis par le Venezuela, devaient financer des projets de reconstruction. Cependant, une grande partie de ces ressources a été détournée, alimentant des scandales de corruption qui continuent de hanter le pays.
Les gouvernements successifs ont utilisé ces fonds pour des inaugurations spectaculaires, mais les résultats tangibles sont rares. Ce scandale illustre le manque de transparence dans la gestion des ressources, un problème récurrent dans les efforts de reconstruction en Haït
Les détournements de fonds et la mauvaise gestion des ressources ont eu des conséquences directes sur la population haïtienne :
- Des milliers de familles déplacées vivent encore dans des conditions précaires, sans accès à des logements décents.
- Les infrastructures critiques, comme les routes et les hôpitaux, restent insuffisantes pour répondre aux besoins de la population.
La corruption a non seulement retardé la reconstruction, mais elle a aussi sapé la confiance des Haïtiens envers les institutions locales et internationales.
15 ans après : une Haïti toujours vulnérable
La montée des crises politiques et sociales
Depuis 2018, Haïti est plongé dans une spirale de violence et d’instabilité :
- La montée en puissance des gangs armés paralyse une grande partie du pays.
- La corruption gangrène les institutions, entravant toute réforme significative.
- Les troubles politiques ont empêché la mise en place de stratégies à long terme pour reconstruire le pays.
Quinze ans après le séisme de 2010, Haïti reste un pays marqué par les promesses non tenues et la corruption endémique. L’affaire de la Croix-Rouge, symbole des échecs de la communauté internationale, illustre l’importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des crises.