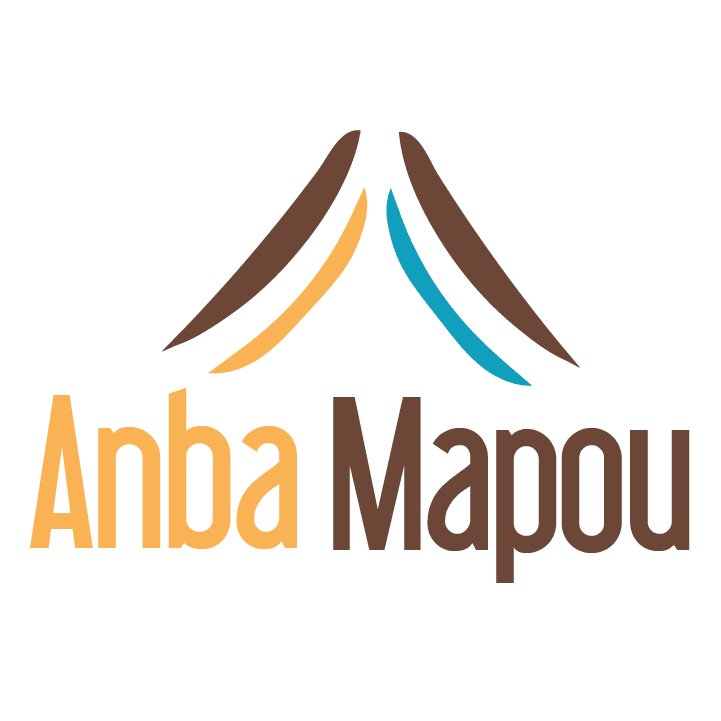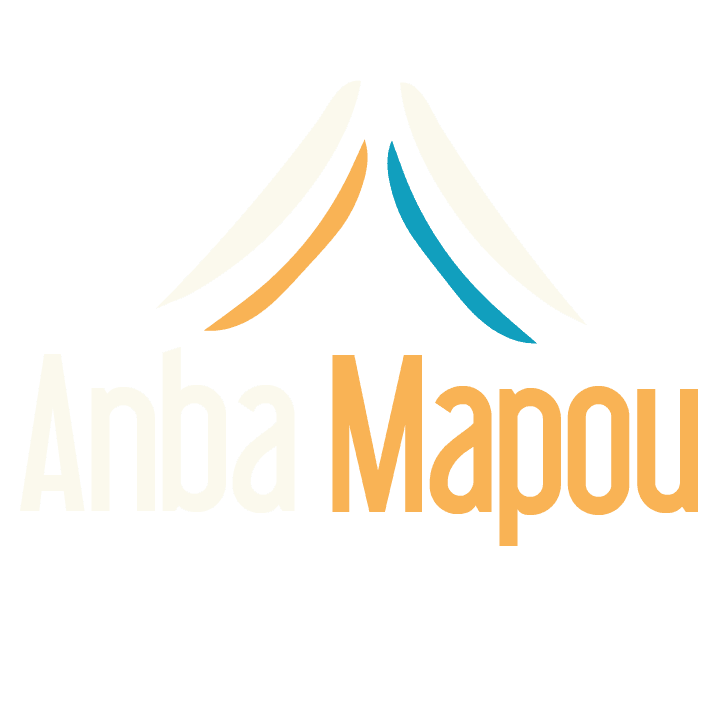Depuis 2018, Haïti a été le théâtre de plus de trente massacres perpétrés par des groupes armés selon acentodiario, plongeant le pays dans une spirale de violence sans fin. Ces événements tragiques, marqués par des assassinats de masse, des viols collectifs, et des disparitions forcées, témoignent d’une crise humanitaire et sécuritaire à son paroxysme.
Deux massacres en une semaine : Cité Soleil et Petite Rivière de l’Artibonite
Cité Soleil : En décembre 2024, le plus grand bidonville d’Haïti a été le théâtre d’un massacre sans précédent. Plus de 180 personnes, principalement des personnes âgées, ont été tuées par les hommes de Micanor Altes, alias « Wa Mikano ». Le chef de gang aurait ordonné cette attaque en accusant les victimes de pratiques de sorcellerie ayant conduit son fils à tomber gravement malade. Aujourd’hui encore, la zone reste sous le contrôle du gang, et aucune intervention de la Police Nationale Haïtienne (PNH) ou de la mission multinationale dirigée par le Kenya n’y a été rapportée.
Petite Rivière de l’Artibonite : Quelques jours plus tard, dans la nuit du 10 au 11 décembre 2024, la bande armée Gran Griff, dirigée par Luckson Elan, a assassiné une vingtaine de personnes dans cette commune. Des familles entières ont été prises pour cible pendant leur sommeil, et plusieurs victimes restent portées disparues. Ce gang, actif depuis 2018, est connu pour ses exactions : meurtres, enlèvements, pillages, et viols collectifs. Ces attaques font écho à un autre massacre récent commis par ce même groupe à Pont Sondé en octobre 2024, où 115 personnes avaient perdu la vie.
Une liste interminable de massacres
En six ans, Haïti a connu une série de massacres qui illustrent la prolifération des gangs et l’impuissance des autorités à rétablir l’ordre , pour les plus récents:
- Wharf Jérémie (décembre 2024) : Plus de 180 morts lors d’une attaque coordonnée par le gang Wa Mikano.
- Canaan (octobre 2024) : Une cinquantaine de morts lors d’une attaque sanglante non suivie d’actions concrètes des forces de sécurité.
- Bel-Air (juin 2024) : 35 morts et des dizaines de maisons incendiées par des bandes armées.
- Village de Dieu (2021) : Une cinquantaine de policiers et civils tués dans une opération qui s’est soldée par un échec cuisant.
Chaque massacre efface l’indignation du précédent, laissant la population sombrer dans un désespoir profond.
Impunité et absence de réponses concrètes
Les bandes criminelles, qui ne représentent que 0,1 % de la population, paralysent pourtant le pays (acentodiario). Leur pouvoir s’étend sur de vastes territoires, rendant des zones entières inaccessibles. Pendant ce temps, les autorités semblent incapables de fournir une réponse adéquate. La PNH, affaiblie et sous-équipée, se concentre sur quelques zones stratégiques comme Nazon et Delmas 6, tandis que les massacres continuent ailleurs.
Le soutien international, bien que présent, reste inefficace face à l’ampleur du problème. La mission multinationale dirigée par le Kenya n’a pas encore réussi à neutraliser les grands bastions des gangs, ce qui soulève des questions sur la coordination et les priorités des opérations.
Conséquences sociales et économiques
Les massacres récurrents ont des conséquences dévastatrices sur le tissu social et l’économie d’Haïti :
- Déplacement de populations : Des milliers de familles ont été contraintes de fuir leurs maisons pour échapper aux violences, surtout après le massacre de Pont Sondé ( Il y a deux semaines, les acteurs de cette région ont manifestés pour réclamer la présence de l’État).
- Effondrement économique : Dans des régions comme l’Artibonite, autrefois considérée comme le grenier à riz du pays, la production agricole a chuté en raison de l’insécurité. Plus de 80% du riz cultivé en Haïti proviennent des 28 mille hectares de plaines irriguées dans la Vallée de l’Artibonite, au Nord de la capitale Port-au-Prince selon Le Nouvelliste et concentre plus de 50% des superficies plantées en riz dans le pays selon Ayibopost. Cependant, la production y souffre(BID) et Alterpress, l’insécurité est surtout la cause majeure.
- Traumatismes collectifs : Les témoignages de survivants révèlent une souffrance psychologique profonde qui pourrait marquer plusieurs générations.