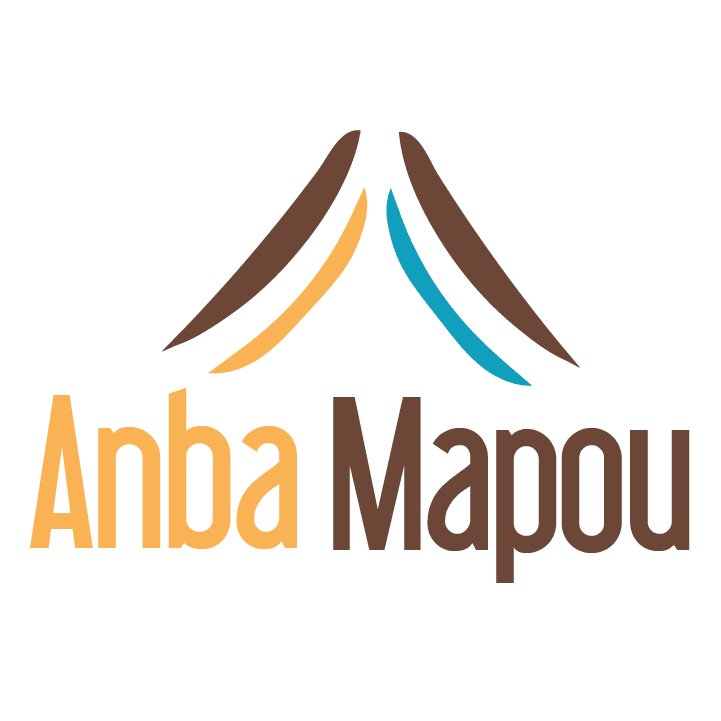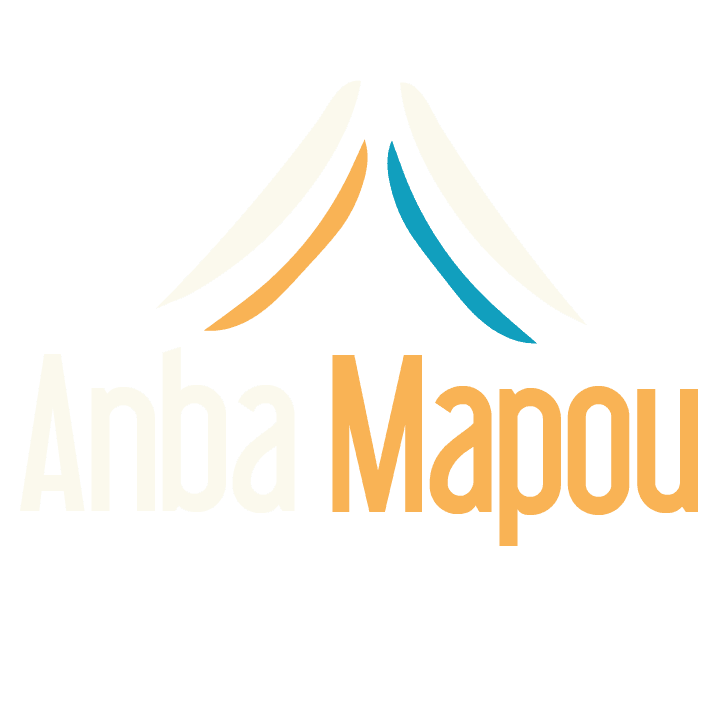Le 16 décembre 2024 restera gravé dans la mémoire collective comme une autre journée marquée par la désillusion en Haïti. La rencontre entre les parties prenantes de l’accord du 3 avril, organisée sous l’égide de la CARICOM, n’a fait que renforcer l’image d’un système politique profondément corrompu et dysfonctionnel. Entre la honte nationale que représente l’intervention d’une institution étrangère pour gérer des désaccords internes, et les scandales de corruption qui éclaboussent les dirigeants, la génération actuelle d’hommes politiques haïtiens continue de ternir l’héritage de ce pays, autrefois pionnier de la lutte pour la liberté.
Un théâtre d’incohérence politique
La réunion de la CARICOM a une fois de plus révélé l’ampleur des divisions au sein de la classe politique haïtienne. Si certains participants ont plaidé pour une réorganisation complète du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), d’autres ont défendu son maintien, malgré les accusations de corruption qui pèsent sur trois de ses membres. Les désaccords sur des questions aussi fondamentales que la lutte contre la corruption ou l’organisation d’élections libres témoignent d’une incapacité chronique à dépasser les querelles partisanes pour servir l’intérêt général.
Patrick Norzéus, représentant de la plateforme RED, a dénoncé l’hypocrisie de certains acteurs politiques, accusés d’avoir dilapidé les ressources publiques par le passé. Cette déclaration, bien qu’accusatrice, reflète une triste vérité : la classe politique haïtienne, dans sa majorité, est gangrenée par des pratiques qui sapent la confiance du peuple.
La CARICOM : un pansement sur une plaie béante
L’intervention de la CARICOM dans cette crise est symptomatique de la perte de souveraineté d’Haïti. L’organisation régionale, bien qu’animée par des intentions louables, agit comme un intermédiaire entre des acteurs politiques haïtiens incapables de se mettre d’accord par eux-mêmes.
Ce recours à une institution étrangère pour résoudre des différends internes est un aveu d’échec pour une élite politique qui, depuis des décennies, échoue à instaurer un État de droit fonctionnel. Pire encore, la CARICOM a jusqu’ici montré ses limites, en étant incapable de proposer des solutions viables à la crise actuelle. Ses trois précédentes missions en Haïti se sont soldées par des échecs retentissants, faute de coopération entre les protagonistes.
La corruption comme pilier du système
L’affaire de la Banque Nationale de Crédit (BNC), impliquant trois membres du CPT, illustre parfaitement l’ampleur de la corruption au sein des institutions de transition. Accusés d’avoir sollicité 100 millions de gourdes en pots-de-vin, ces conseillers présidentiels refusent de répondre à la justice, invoquant des arguments juridiques fallacieux.
Me Camille Leblanc, ancien ministre de la Justice, a dénoncé cette imposture, rappelant que ces conseillers ne bénéficient d’aucune immunité présidentielle. Pourtant, leur refus de se soumettre à l’enquête judiciaire témoigne d’un mépris flagrant pour les lois du pays.
Cette situation met également en lumière la politisation de la justice, incapable de mener à bien des enquêtes sur des personnalités influentes. L’indépendance du système judiciaire, pourtant essentielle à l’État de droit, est systématiquement compromise par des pressions politiques.
Une génération déconnectée des aspirations populaires
Les hommes politiques actuels, qu’ils soient issus du pouvoir ou de l’opposition, semblent bien éloignés des réalités vécues par la population haïtienne. Alors que l’insécurité, la pauvreté et l’instabilité atteignent des niveaux alarmants, les dirigeants s’enlisent dans des querelles stériles.
Cette génération, censée incarner l’avenir du pays, s’illustre par son incapacité à proposer une vision claire pour sortir Haïti du chaos. À la place, elle perpétue un système basé sur le clientélisme, l’enrichissement personnel et l’instrumentalisation des institutions publiques.
La honte d’un pays autrefois souverain
Il est difficile de ne pas comparer cette situation avec le passé glorieux d’Haïti, première république noire indépendante au monde. La génération actuelle de politiciens a trahi cet héritage, laissant le pays dépendant des interventions étrangères pour gérer ses crises.
La CARICOM, tout comme d’autres acteurs internationaux, ne devrait pas avoir à intervenir pour imposer des solutions. C’est à Haïti de prouver qu’il peut résoudre ses problèmes sans aide extérieure. Pourtant, l’élite politique continue de démontrer qu’elle est incapable de dépasser ses propres intérêts pour le bien du pays.
La génération actuelle d’hommes politiques haïtiens porte une lourde responsabilité dans l’effondrement de l’État et la détresse de la population. Leur incapacité à gérer la crise, combinée à leur attachement à des pratiques corrompues, appelle à une refondation complète du système politique.
Il est impératif que la société civile, les jeunes générations et les mouvements populaires prennent le relais, pour offrir à Haïti une véritable chance de renaissance. La souveraineté et la dignité de ce pays ne peuvent être restaurées que si ses dirigeants futurs s’engagent à rompre avec les pratiques du passé et à œuvrer sincèrement pour le bien commun.