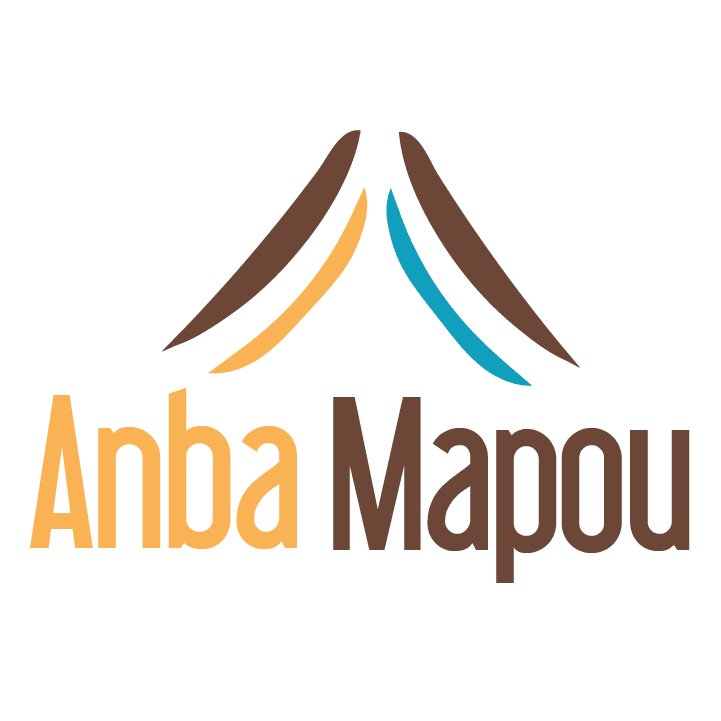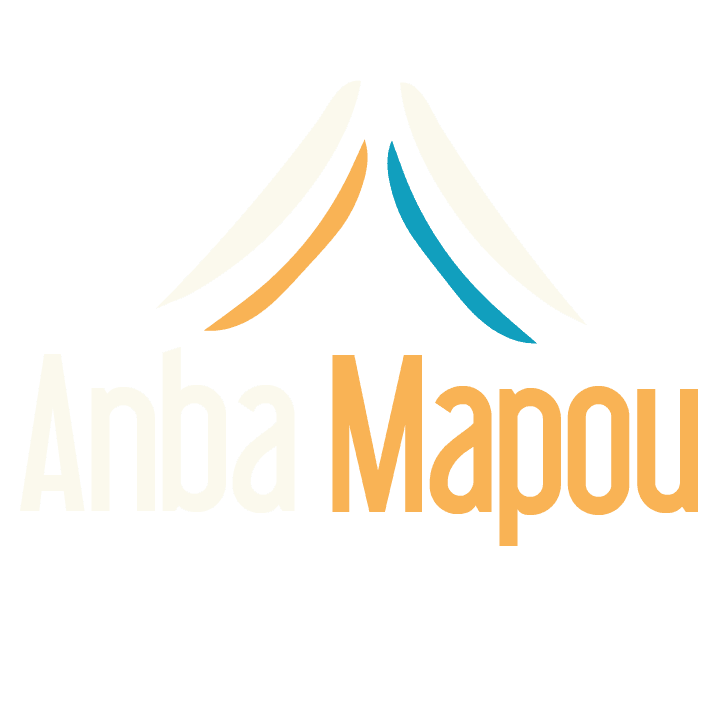À quelques jours de l’investiture de Nicolás Maduro pour un nouveau mandat présidentiel, Edmundo González Urrutia, figure de l’opposition vénézuélienne, a rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche. Cette entrevue met en lumière une politique américaine critiquée pour son usage stratégique des principes démocratiques dans les affaires internationales.
Edmundo González, candidat de l’opposition lors des élections présidentielles de juillet 2024, a annoncé avoir eu une discussion « constructive » avec le président américain. Cet échange intervient dans un contexte où Washington a reconnu González comme le dirigeant légitime du Venezuela, remettant en question la proclamation officielle de Maduro par le Conseil National Électoral.
Ce soutien unilatéral révèle une stratégie déjà observée par le passé, notamment avec Juan Guaidó, sans succès concret dans la remise en cause de l’autorité de Maduro. Les États-Unis affichent ainsi une vision utilitaire de la démocratie, favorisant les opposants dans les pays qu’ils perçoivent comme hostiles tout en ignorant des dérives similaires chez leurs partenaires stratégiques.
En prônant la défense des valeurs démocratiques, Washington continue de soutenir des candidats ou des coalitions proches de ses intérêts. Toutefois, cette posture suscite des interrogations sur sa cohérence, notamment lorsqu’elle s’accompagne d’actions contraires aux principes de non-ingérence.
L’absence de preuves solides concernant des fraudes électorales massives n’a pas empêché les États-Unis de reconnaître González comme président élu, défiant ainsi les institutions vénézuéliennes. Ce positionnement, considéré par Caracas comme une interférence, alimente des tensions diplomatiques et renforce l’idée que ces interventions relèvent davantage de calculs politiques que d’un véritable souci pour les droits des peuples.
En amont de son entrevue à Washington, González a multiplié les déplacements en Amérique latine. Reçu à Buenos Aires par Javier Milei, il a affirmé vouloir rentrer à Caracas pour « exercer le mandat que lui aurait confié la population ». Ces déclarations visent à renforcer sa visibilité et consolider une alliance internationale en sa faveur, malgré une légitimité contestée.
En parallèle, des nations comme le Brésil ou l’Union européenne continuent de dénoncer le processus électoral vénézuélien tout en appelant à des dialogues politiques. À l’opposé, d’autres États, dont la Russie et la Chine, maintiennent leur reconnaissance de Maduro, considérant ces critiques comme une tentative de déstabilisation orchestrée par des puissances occidentales.
Alors que l’investiture de Maduro approche, la capitale vénézuélienne se prépare à des mouvements susceptibles d’intensifier les divisions internes. Les propos de González affirmant sa victoire et son intention de prendre le pouvoir augmentent les risques d’incidents. Maduro, lui, accuse ses opposants et leurs alliés étrangers de chercher à provoquer une rupture de l’ordre institutionnel.
Les sanctions imposées par les États-Unis et leurs partenaires, bien qu’ayant visé à affaiblir le régime chaviste, ont surtout aggravé la situation économique du pays sans parvenir à modifier l’équilibre du pouvoir. Ces mesures, perçues par certains comme un levier de domination économique, interrogent sur leur efficacité réelle et leur coût humain.
Cette rencontre entre Biden et González symbolise une approche controversée des relations internationales où les principes démocratiques servent d’instruments pour justifier des ingérences. Le contraste entre les discours affichés et les pratiques observées alimente un sentiment de méfiance croissant vis-à-vis des intentions réelles des grandes puissances.
À travers le soutien à González, les États-Unis démontrent une application asymétrique des valeurs démocratiques. Cette stratégie, qui fragilise les institutions locales et ignore les impacts sur les populations, illustre les limites d’une politique étrangère qui privilégie les intérêts stratégiques au détriment d’une cohérence véritablement fondée sur les droits et la souveraineté des nations. Nous avons Gaza, ses relations avec des pays au Moyen-Orient, prenons la Syrie où ils collabèrent actuellement avec un Terroriste… les exemples sont nombreux.