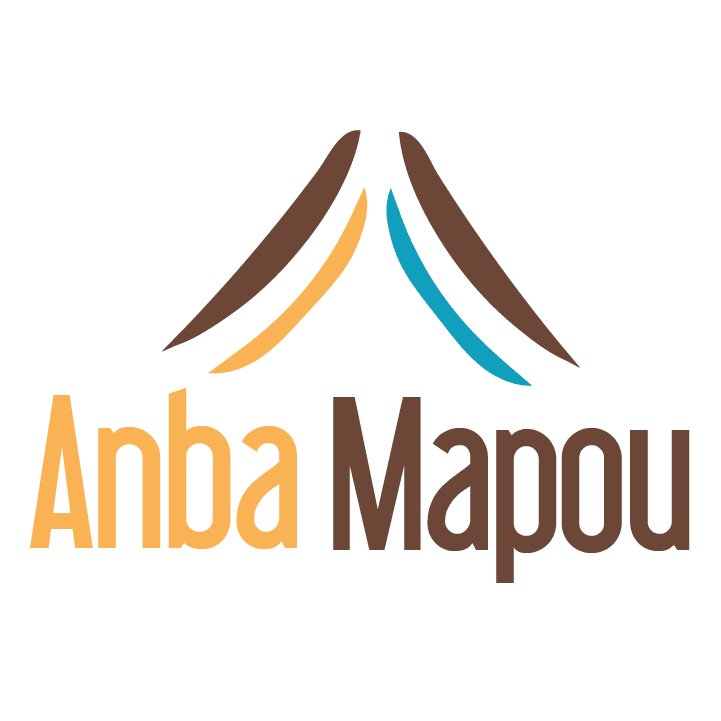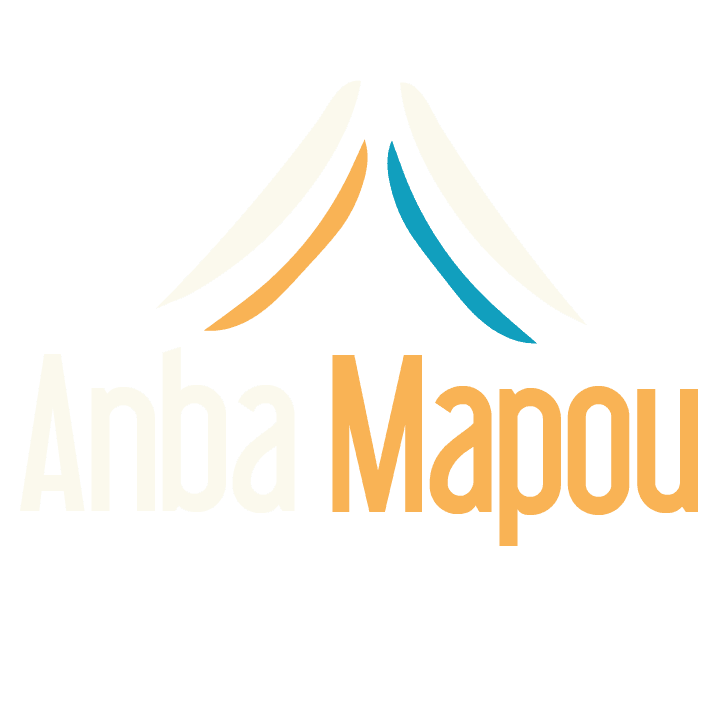Une expansion incontrôlée
Lundi, la tension a atteint son paroxysme à Lascahobas. Un affrontement violent entre des policiers du commissariat local et des agents de la Brigade de Sécurité des Aires Protégées (BSAP) a causé des blessures par balles à quatre personnes, dont un journaliste. La colère populaire s’est intensifiée avec l’incendie de deux véhicules appartenant à la BSAP.
Furieuse de la présence de ces agents dans la commune, une partie de la population a saccagé leur lieu d’hébergement, contraignant les membres de la BSAP à fuir pour éviter de nouveaux affrontements.
Cette escalade de violence trouve son origine dans un incident survenu la veille : des agents de la BSAP auraient violemment agressé un membre de l’unité Polifront. Ce dernier aurait refusé de se plier à leurs directives, les agents de la brigade ayant décidé de gérer la circulation à Lascahobas, une tâche bien éloignée de leur mission principale, axée sur la protection des aires naturelles. @mapou_a
À sa création en 2006, le CSE comptait 32 agents, selon Jean François Thomas, qui avait participé à son lancement selon un article d’Ayibopost publié le 22 décembre. Depuis 2017, les effectifs de la Brigade de Sécurité des Aires Protégées (BSAP) ont explosé. Initialement composée d’une centaine d’agents, cette unité compterait aujourd’hui entre 3000 et 6072 membres, selon les sources (Frantz Daniel Pierre et Jeantel Joseph). Cependant, cette croissance rapide s’accompagne d’une gestion chaotique, marquée par des recrutements arbitraires et une absence de contrôle sur les activités des agents.
Les armes, au cœur des inquiétudes, échappent largement à toute régulation. D’après des témoignages recueillis auprès de responsables, bon nombre des agents se procurent eux-mêmes leur équipement, souvent constitué d’armes de gros calibre dont l’origine reste floue. Ces dysfonctionnements reflètent l’absence de supervision et les failles profondes dans le fonctionnement de la BSAP.
Créée pour protéger les 24 aires protégées du pays, la BSAP a progressivement dérivé de sa vocation initiale. Ces zones, classées selon leur statut – patrimoine mondial, parcs nationaux, ou zones de protection de la biodiversité – devraient être surveillées et préservées par des agents formés à la gestion environnementale. Pourtant, de nombreux membres de la BSAP ignorent les bases de cette mission.
Certains agents se sont impliqués dans des activités très éloignées de leur mandat, allant jusqu’à participer à des affaires criminelles ou politiques. En janvier 2024, des dizaines d’entre eux ont soutenu une rébellion menée par Guy Philippe, ancien chef rebelle, contre le gouvernement en place. Ce type d’implication illustre à quel point la brigade est devenue un instrument de chaos plutôt qu’un outil de protection environnementale.
Le port d’armes au sein de la BSAP constitue l’un des problèmes les plus préoccupants. Les autorités responsables de l’encadrement de la brigade, comme la Police Nationale d’Haïti (PNH) ou l’armée, n’ont aucun contrôle sur les équipements en circulation. Les armes utilisées par les agents, souvent issues de stocks non enregistrés, échappent aux réglementations officielles.
Des témoignages rapportent que certains agents considèrent que leur adhésion à la BSAP confère automatiquement une légitimité à leurs armes. Pourtant, seules la PNH et l’armée sont habilitées à délivrer des certificats de légalité pour ces équipements. Cette confusion sur les responsabilités légales contribue à renforcer l’impunité au sein du corps.
En 2024, une tentative gouvernementale visant à interdire le port d’armes pour les agents de la BSAP a été largement ignorée. Selon certains responsables, cette mesure, bien qu’indispensable, n’a pas été appliquée en raison du manque de volonté politique et de l’influence exercée par des factions internes à la brigade.
Les failles dans le processus de recrutement de la BSAP aggravent encore les problèmes structurels. Contrairement à la PNH, qui impose des critères stricts de sélection, la BSAP ne fixe aucune limite d’âge ou niveau académique pour intégrer ses rangs, Ayibopost propose un excellent article sur ce sujet. Cette absence de rigueur attire des individus aux motivations souvent douteuses, comme ceux cherchant à légaliser des armes détenues illégalement.
En 2022, des enquêtes ont révélé que des agents étaient impliqués dans des affaires de kidnapping et d’autres actes criminels graves. Ces exactions, parfois imputées au ministère de l’Environnement sous lequel opère la BSAP, entachent encore davantage l’image de l’institution.
Les relations tendues entre la BSAP et la PNH exacerbent les dysfonctionnements de la brigade. En octobre 2024, un incident à Ouanaminthe a mis en lumière cette rivalité. Un contrôle routier s’est transformé en confrontation violente, où des agents de la BSAP ont été agressés par des policiers. En représailles, la BSAP a bloqué une route stratégique, paralysant la circulation locale pendant plusieurs heures.
Ces tensions ne se limitent pas à des affrontements isolés. Lors des manifestations antigouvernementales de février 2024, cinq agents de la BSAP ont été tués par des policiers, tandis que trois autres ont été arrêtés. Ces conflits illustrent l’absence de coordination entre les forces censées collaborer pour maintenir l’ordre et protéger les citoyens.
L’absence d’un cadre légal clair pour réguler les activités de la BSAP constitue une faille majeure. Depuis sa création en 2006, cette brigade a été placée sous la tutelle de plusieurs institutions sans qu’aucune n’ait réellement pris en charge sa supervision. En 2017, lorsque l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP) a été élevée au rang de direction générale, elle a hérité des agents et du matériel de l’ancien Corps de Surveillance Environnementale (CSE).
Cependant, cette transition n’a pas permis de structurer efficacement le corps. Des commissions mises en place entre 2021 et 2024 pour réformer la brigade ont échoué à apporter des solutions durables. L’une des principales lacunes identifiées concerne l’absence de documentation officielle sur les armes en possession des agents.
Les dérives observées au sein de la BSAP reflètent également une instrumentalisation politique récurrente. Les agents de la brigade ont souvent été mobilisés pour des causes partisanes, au détriment de leur mission environnementale. Cette situation est aggravée par l’absence de financement stable. En 2024, seuls 140 agents sur les milliers composant la brigade étaient officiellement rémunérés par le budget de l’ANAP selon Ayiobopost.
Le reste des effectifs, composés en grande partie de volontaires, dépend de réseaux informels pour subvenir à leurs besoins. Cette précarité alimente des comportements opportunistes, voire criminels, parmi les membres de la BSAP.
Pour remédier aux problèmes systémiques de la BSAP, plusieurs propositions ont été avancées. Certains plaident pour une refonte complète du corps, en le plaçant sous la tutelle directe de l’armée ou de la PNH. Cette mesure pourrait permettre d’instaurer un contrôle plus strict sur les armes et les activités des agents.
D’autres estiment qu’un renforcement des formations et des critères de recrutement est indispensable pour recentrer la brigade sur sa mission environnementale. Cependant, sans volonté politique forte, ces solutions risquent de rester lettre morte.
En l’état actuel, la BSAP représente un danger pour la stabilité d’Haïti. Ses effectifs croissants, son armement incontrôlé et son instrumentalisation politique en font un facteur d’instabilité majeur. Tant que des réformes structurelles ne seront pas mises en œuvre, la brigade continuera de poser plus de problèmes qu’elle n’en résout.