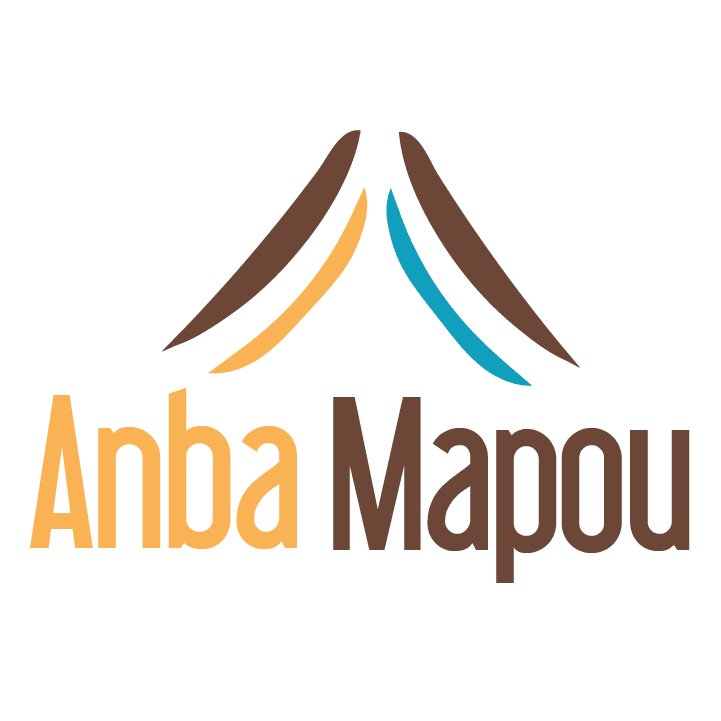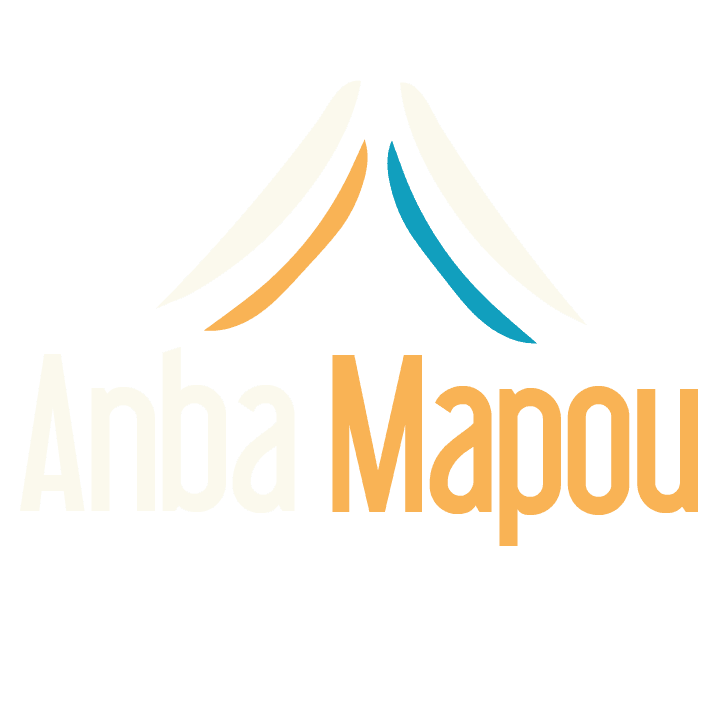En Haïti, les massacres se succèdent avec une régularité glaçante. Pourtant, face à l’effusion de sang, les autorités persistent dans leur inaction, se contentant de condamner verbalement avant de reprendre leurs jeux de pouvoir. Les populations, laissées à elles-mêmes, subissent en silence l’absence de protection et de justice.
Massacre au wharf Jérémie : entre barbarie et silence complice
Début décembre 2024, le Wharf Jérémie, à Cité-Soleil, a été le théâtre d’une atrocité sans précédent. Le chef de gang Micanor Altes, alias « Wa Mikanò », a orchestré le massacre de plus de 120 vieillards dans le cadre d’un rituel mystique visant à renforcer son pouvoir. Ces actes d’une cruauté inimaginable ont choqué la nation : certaines victimes ont été enterrées vivantes, tandis que d’autres ont été décapitées.
Le gouvernement, fidèle à son habitude, a publié une note de condamnation sans mettre en œuvre de mesures concrètes. Pendant ce temps, les gangs continuent de régner sur Cité-Soleil, piétinant une population abandonnée. Plus préoccupées par des querelles de partage de pouvoir, les autorités n’ont jusqu’ici montré aucune volonté réelle de rétablir la sécurité.
Pont-Sondé : une localité abandonnée face à la terreur du Gang gran grif
Le 3 octobre 2024, le gang Gran Grif a semé la terreur à Pont-Sondé, massacrant au moins 115 personnes. Ce carnage, d’une violence inouïe, était une vengeance contre des habitants soupçonnés de collaborer avec un groupe local cherchant à contrer l’influence des gangs. Depuis, cette localité de l’Artibonite s’enfonce dans une spirale de violence, tandis que les autorités brillent par leur absence.
Les habitants, réduits à organiser leur propre défense, paient un prix élevé pour leur résilience. Les rares tentatives de collaboration entre la population et la police, comme celle de juillet 2024 pour repousser une attaque contre un commissariat, sont insuffisantes face à l’ampleur de la menace. Le silence prolongé des dirigeants face à ces atrocités équivaut à une complicité tacite.
Inondations meurtrières : des vies balayées, des dirigeants indifférents
En parallèle de ces massacres, Haïti est frappée par une série de catastrophes naturelles, aggravées par l’inaction gouvernementale. Entre le 30 novembre et le 2 décembre 2024, des pluies torrentielles ont causé des inondations dévastatrices dans plusieurs départements, notamment à Jérémie, où trois morts et des centaines de sinistrés ont été recensés.
Malgré l’urgence humanitaire, le gouvernement a mis trois jours pour publier un communiqué appelant simplement à la vigilance. Pendant que des familles luttaient pour sauver leurs maigres biens, le Conseil présidentiel de transition (CPT) discutait… de la nomination des membres du Conseil électoral provisoire.
Les 5,2 millions de dollars annoncés pour un prétendu plan d’action restent invisibles sur le terrain. Les inondations ne sont que le dernier exemple d’une gestion catastrophique, où l’absence d’infrastructures adéquates et de plans d’urgence transforme chaque intempérie en désastre national.
Une transition politique vidée de sens
La priorité affichée du gouvernement – élections, réformes constitutionnelles et conférences nationales – est perçue comme un exercice cynique de conservation du pouvoir, loin des réalités quotidiennes des citoyens. Cette indifférence flagrante creuse davantage le fossé entre une classe dirigeante déconnectée et une population en détresse.
Entre massacres et catastrophes naturelles : le cri d’une nation oubliée
Haïti est à un carrefour tragique où l’effondrement de l’État laisse place à un chaos meurtrier. Chaque massacre, chaque inondation révèle l’échec systémique d’un appareil étatique incapable de protéger ses citoyens. Pendant que les dirigeants se concentrent sur leur survie politique, les Haïtiens luttent seuls pour leur survie physique.