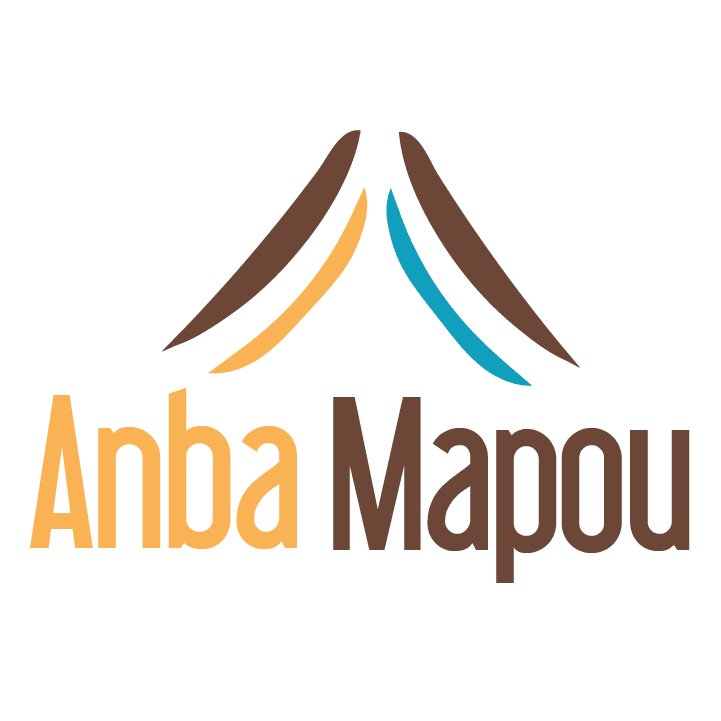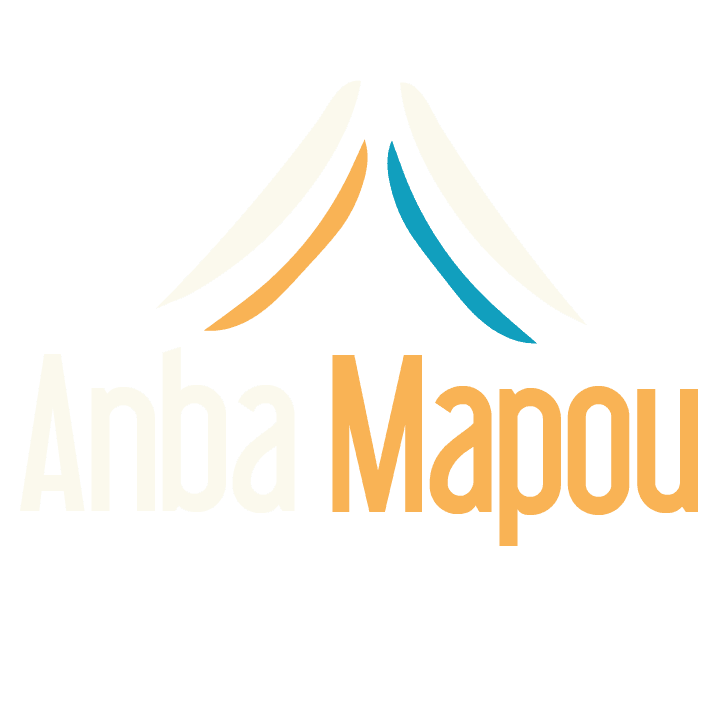La région des Caraïbes est confrontée à une montée alarmante de la violence et de l’instabilité, avec deux pays, Trinidad-et-Tobago et Haïti, particulièrement affectés par des crises liées à l’activité des gangs. Bien que les contextes soient différents, ces nations partagent des défis communs liés à l’insécurité et à l’instabilité politique.
Le 30 décembre dernier, le gouvernement de Trinidad-et-Tobago a déclaré un état d’urgence suite à une flambée de violences, dont le meurtre de sept personnes entre le 27 et le 29 décembre. Parmi ces victimes, cinq ont été tuées lors d’une seule fusillade à Laventille.
Ce dispositif, prévu pour trois mois, accorde à la police des pouvoirs élargis, comme la possibilité d’arrêter des individus sans inculpation pendant 48 heures et de procéder à des perquisitions sans mandat.
Sandra Pellegrini, analyste senior de l’organisation ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), a souligné la gravité de la situation :
« Nos données montrent une augmentation de 28 % des violences liées aux gangs au cours des six dernières années. La violence ne se limite plus à des zones à risque mais s’étend à un nombre croissant de communautés. »
En 2024, des incidents violents ont été recensés dans au moins 90 localités, illustrant l’expansion de l’activité des gangs à travers le pays.
La position stratégique de Trinidad-et-Tobago en tant que point de destination et de transit pour les marchandises illicites, notamment les drogues et les armes, a aggravé la situation. Malgré les mesures d’urgence, les experts avertissent que ces initiatives offrent une solution temporaire mais ne s’attaquent pas aux causes profondes du problème, telles que :
- La disponibilité généralisée des armes à feu.
- Les inégalités économiques et sociales.
Avec des élections générales prévues le 10 août 2025, la question de la sécurité devrait devenir un thème central du débat politique. La capacité du gouvernement à contenir la violence des gangs influencera fortement l’opinion publique et les résultats électoraux.
Haïti a enregistré en décembre 2024 son mois le plus meurtrier pour les civils depuis 2018. Les gangs opérant à Port-au-Prince et dans le département de l’Artibonite ont multiplié les attaques, causant des centaines de morts.
- 6-8 décembre : Le gang Wharf Jérémie, dirigé par « Micanor », a massacré au moins 207 habitants à Cité Soleil après qu’un prêtre vaudou a été accusé d’avoir utilisé la sorcellerie pour rendre malade le fils du chef de gang.
- 10 décembre : Les gangs Gran Grif, Lika et Palmiste ont attaqué plusieurs villages de l’Artibonite, tuant au moins 70 personnes en représailles à une intervention conjointe de la police et d’un groupe d’autodéfense local.
Ces événements ont conduit le conseil présidentiel de transition haïtien à déclarer un état d’urgence du 22 décembre au 21 janvier et à former un conseil national de sécurité pour gérer la situation.
Malgré des opérations de police intensifiées et l’aide internationale, notamment l’intervention des forces de soutien multinational dirigées par le Kenya (MSS), les progrès restent limités. En 2024 :
- Les affrontements entre forces de sécurité et gangs ont augmenté de 40 %.
- Les gangs ont continué d’étendre leur contrôle territorial, sapant les efforts de rétablissement de l’ordre.
L’attaque contre l’hôpital Bernard Mevs, un centre médical clé de Port-au-Prince, illustre la gravité de la crise.
Le mandat des forces MSS a été prolongé d’une année supplémentaire, avec l’arrivée de renforts d’Amérique centrale en janvier 2025. Cependant, plusieurs défis subsistent :
- Renforcer les capacités des forces de sécurité haïtiennes.
- Garantir la sécurité des civils face aux violences continues.
- Stabiliser le pays pour permettre des élections démocratiques d’ici 2026.
Bien que Trinidad-et-Tobago et Haïti affrontent des contextes distincts, leurs crises partagent des caractéristiques similaires :
- L’influence des gangs : Dans les deux pays, les gangs exploitent les vulnérabilités socio-économiques et la disponibilité des ressources illicites pour asseoir leur pouvoir.
- Mesures d’urgence : Les états d’urgence offrent des solutions à court terme mais échouent souvent à traiter les causes structurelles des violences.
- Conséquences politiques : L’insécurité redéfinit les priorités politiques, obligeant les gouvernements à inclure la sécurité publique dans leurs agendas électoraux.