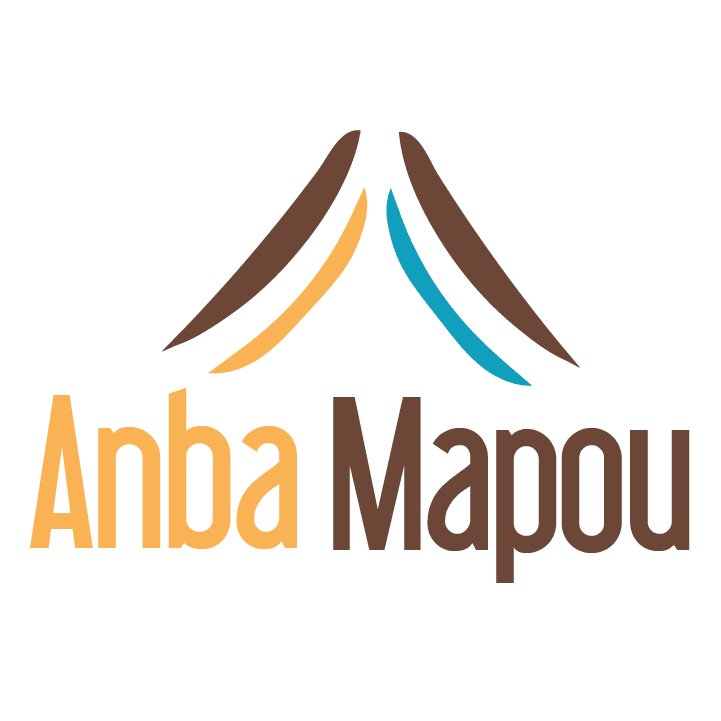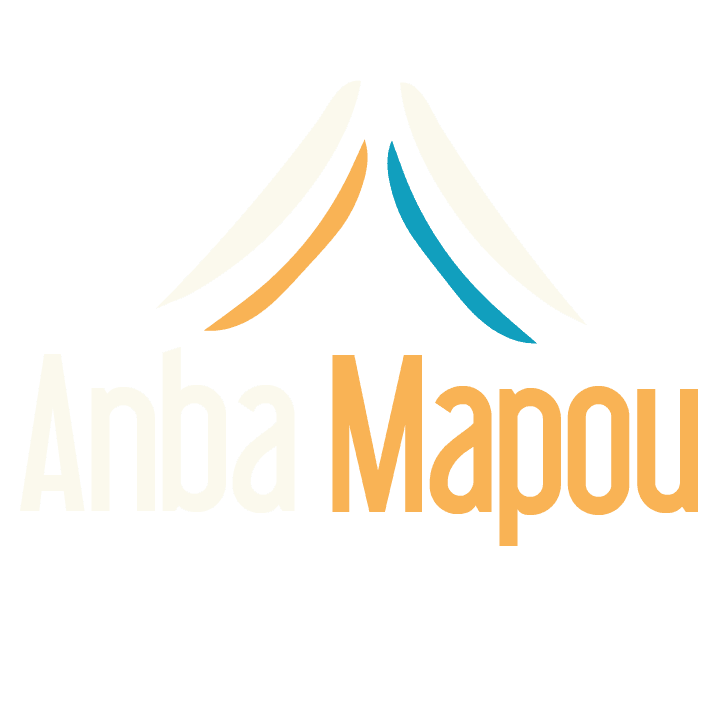L’administration américaine, sous l’impulsion de Donald Trump, a décidé de suspendre toutes les aides internationales pour une période de 90 jours, à l’exception de certaines formes d’assistance militaire et alimentaire destinées à l’Égypte et à Israël. Cette décision fait suite à un ordre exécutif signé par le président et prévoit une révision approfondie des programmes financés, dans le but de les aligner sur les priorités de la politique étrangère de l’administration en place.
Selon une note interne du Département d’État, obtenue par le Miami Herald, cette suspension implique que, à compter de maintenant, aucun engagement financier nouveau ne sera pris dans le cadre de l’aide internationale. De plus, les paiements pour les projets approuvés sont gelés jusqu’à nouvel ordre. Les responsables de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et leurs partenaires ont été informés de cette décision par courrier électronique.
Cette suspension concerne également Haïti, un pays où les États-Unis jouent un rôle crucial dans des domaines comme la santé, la sécurité et le développement. Bien que Washington ne finance pas directement le gouvernement haïtien, son appui se traduit par des investissements stratégiques, notamment dans la formation et l’équipement de la Police Nationale d’Haïti (PNH), essentielle dans la lutte contre les gangs armés.
Avec un budget national déjà très limité, évalué à 2,5 milliards de dollars pour près de 12 millions d’habitants, Haïti pourrait voir sa situation empirer à cause de cette décision. Les conséquences se font déjà sentir. Un administrateur hospitalier a rapporté l’impossibilité de débloquer des fonds approuvés pour des programmes VIH/SIDA. Le plus ancien quotidien du pays, Le Nouvelliste, a également annoncé la fin des financements publicitaires financés par USAID.
Les organisations humanitaires s’alarment également. Partners in Health, qui gère l’Hôpital Universitaire de Mirebalais, affirme que l’arrêt de l’aide compromet des progrès significatifs en matière de santé mondiale. Selon le Dr Joia Mukherjee, cet arrêt risque d’entraîner une résurgence de maladies comme le VIH et la tuberculose, affectant les populations les plus vulnérables.
Des parlementaires démocrates, dont Gregory Meeks et Lois Frankel, ont exprimé leur indignation dans une lettre adressée au secrétaire d’État Marco Rubio. Selon eux, cette suspension « coûtera des vies ». Ils rappellent que l’aide américaine, loin d’être un simple acte de générosité, représente un investissement stratégique pour la stabilité mondiale et les intérêts des États-Unis.
En parallèle, le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé ses préoccupations face à l’intensification des violences en Haïti et à la crise humanitaire grandissante. Des représentants, comme celui de la Chine, ont appelé les États-Unis à assumer leurs responsabilités face à l’arrivée d’armes illégales dans le pays.
Cette suspension pourrait également affecter la mission de soutien sécuritaire dirigée par le Kenya, approuvée par les Nations Unies pour aider Haïti à contrer les gangs armés. Bien que le gouvernement américain ait fourni plus de 600 millions de dollars à cette mission, l’incertitude plane sur les fonds non encore débloqués. En l’absence d’une aide supplémentaire, la mission pourrait être paralysée.
En 2022, plus de 5 600 personnes ont été tuées en Haïti à cause de la violence des gangs. Plus d’un million d’habitants ont dû fuir leur foyer, et près de six millions de personnes ont un besoin urgent d’aide humanitaire. Les infrastructures essentielles, comme les hôpitaux et les écoles, sont sous la menace constante des attaques.
La suspension de l’aide américaine intervient alors que Haïti est confronté à une instabilité politique profonde. Un nouveau gouvernement de transition a été mis en place, mais les élections pour désigner un président et un parlement ne sont prévues qu’en 2026. Entre-temps, la population reste livrée à elle-même face à une crise humanitaire sans précédent.
La semaine prochaine, Marco Rubio effectuera sa première visite officielle dans la région, notamment au Panama, au Guatemala et en République Dominicaine. Cette tournée soulève des interrogations sur les engagements futurs des États-Unis envers leurs partenaires régionaux et sur les mesures concrètes pour faire face à la crise en Haïti.