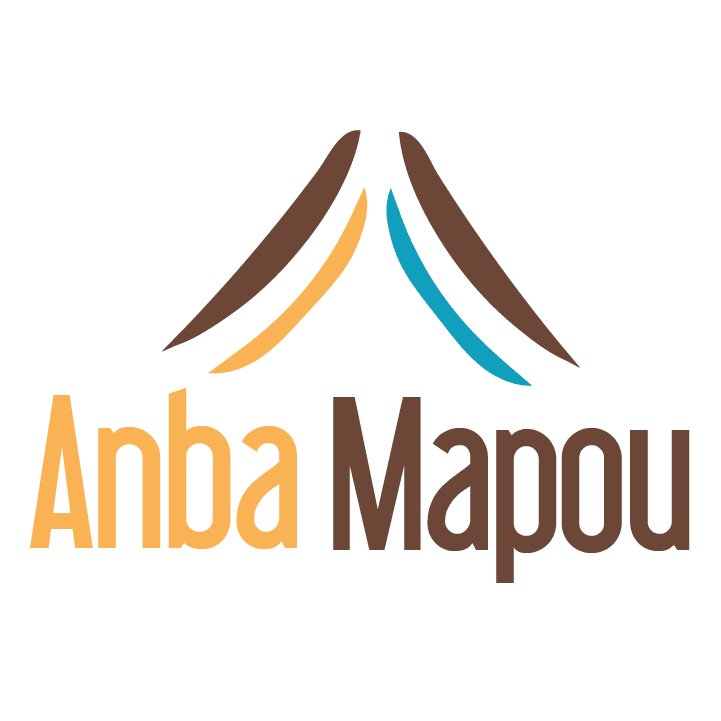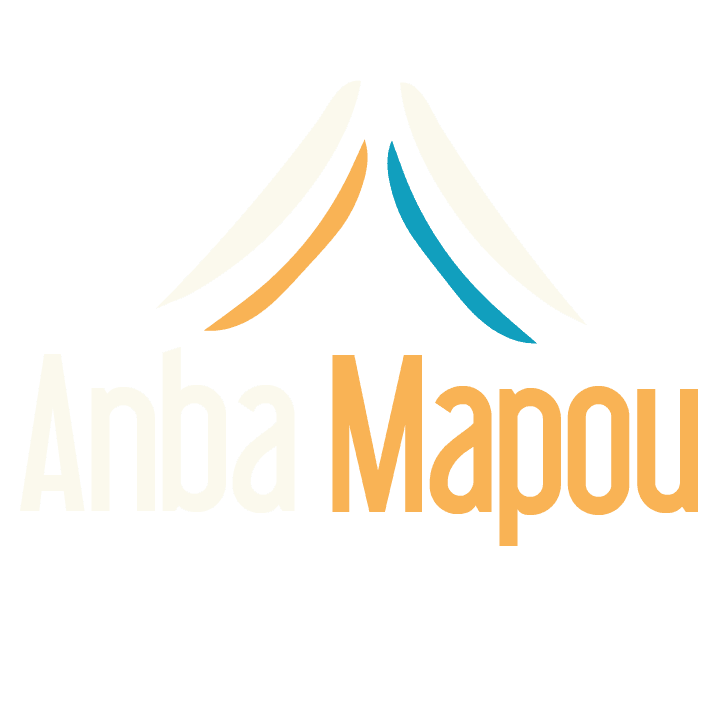Alors que l’Union Européenne mobilise des centaines de milliards pour soutenir l’Ukraine, elle semble adopter une posture de gestion symbolique face à la crise humanitaire et sécuritaire en Haïti. Les récentes sanctions imposées à trois chefs de gangs haïtiens illustrent un contraste saisissant dans l’approche de l’Union vis-à-vis des crises mondiales. Cette dualité interroge : pourquoi tant de générosité pour l’un et si peu pour l’autre ?
Sanctions ciblées en Haïti : un geste tardif et limité
Lundi dernier, la Commission Européenne a annoncé des sanctions contre trois figures majeures de gangs criminels en Haïti, affiliées à la coalition G9, souvent liée au régime controversé du Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK). Ces sanctions visent Jonel Catel, chef du gang Terre Noir, Gabriel Jean-Pierre, leader de la coalition GPep, et Ferdens Tilus, dirigeant du gang Kokorat San Ras. Accusés de vols, enlèvements, extorsions, viols et meurtres, ces individus voient désormais leurs avoirs gelés et leurs déplacements interdits dans l’Union Européenne.
Ces mesures, bien que nécessaires, restent insuffisantes pour résoudre la violence qui gangrène Haïti. Le Conseil Européen avait déjà exprimé, en octobre 2024, sa préoccupation face à la détérioration sécuritaire en Haïti, appelant à des sanctions ciblées pour rétablir la paix et la démocratie. Cependant, l’UE évite d’aborder directement les racines profondes de cette instabilité, notamment le rôle présumé des élites politiques et économiques dans le soutien aux gangs.
Aide à l’Ukraine : des milliards pour une reconstruction ambitieuse
À l’opposé, l’UE affiche une implication massive en Ukraine, mobilisant depuis février 2022 plus de 143 milliards d’euros sous diverses formes d’aide économique, militaire et humanitaire. À elle seule, l’année 2023 a vu l’UE débloquer 18 milliards d’euros pour maintenir la stabilité macroéconomique de l’Ukraine. Une enveloppe supplémentaire de 50 milliards d’euros a été approuvée pour la période 2024-2027, destinée à financer la reconstruction et la modernisation du pays, tout en soutenant sa candidature à l’Union Européenne.
En matière militaire, l’UE a franchi un cap historique en finançant pour la première fois l’envoi d’armes à un pays en guerre. À ce jour, 11,1 milliards d’euros ont été alloués à l’assistance militaire, incluant la formation de 40 000 soldats ukrainiens.
Sur le plan humanitaire, plus de 3 milliards d’euros ont été consacrés à l’aide aux populations déplacées ou affectées par le conflit, avec des actions allant de la fourniture d’abris temporaires à l’accès à l’éducation.
Haïti : un désintérêt manifeste ?
Face à cette disproportion, la situation haïtienne apparaît reléguée au second plan. Tandis que l’Ukraine bénéficie d’une réponse proactive, coordonnée et financée à grande échelle, les mesures prises pour Haïti restent sporadiques et largement insuffisantes. La décision de sanctionner trois chefs de gangs, bien qu’emblématique, ne s’attaque pas au véritable problème : les réseaux complexes d’influence qui alimentent la violence et maintiennent le pays dans une spirale de pauvreté et d’instabilité.
De plus, contrairement à l’Ukraine, aucune stratégie globale de reconstruction, de soutien institutionnel ou d’aide humanitaire massive n’a été mise en place pour Haïti. Le contraste est d’autant plus frappant que la crise haïtienne est aussi, sinon plus, désespérée, avec une population prise en otage par des groupes armés, une économie en ruine et des institutions défaillantes.
Une approche à deux vitesses
L’Union Européenne justifie son engagement en Ukraine par la nécessité de défendre la souveraineté et la démocratie face à l’agression russe. Cependant, cette posture soulève des questions sur les critères qui déterminent l’ampleur de son aide aux autres nations en crise. Haïti, bien que plus proche géographiquement de certains alliés européens, reste apparemment négligée dans les priorités stratégiques de l’UE.
Les 143 milliards d’euros mobilisés pour l’Ukraine témoignent d’une solidarité admirable, mais mettent également en lumière une gestion asymétrique des crises internationales. Haïti, qui peine à attirer l’attention des grandes puissances, risque de sombrer davantage si des actions concrètes et soutenues ne sont pas engagées.
La disparité flagrante entre les efforts fournis pour l’Ukraine et les mesures prises pour Haïti illustre une politique européenne marquée par des choix géostratégiques plutôt que par une vision équitable de la solidarité internationale. Alors que des milliards sont mobilisés pour reconstruire et moderniser l’Ukraine, Haïti reste enfermé dans un cycle de violence, sans véritable soutien pour sortir de l’abîme.
À l’heure où l’Union Européenne revendique un rôle de leader moral sur la scène mondiale, la gestion contrastée de ces crises met à mal ses discours sur l’universalité des droits humains et la solidarité internationale.