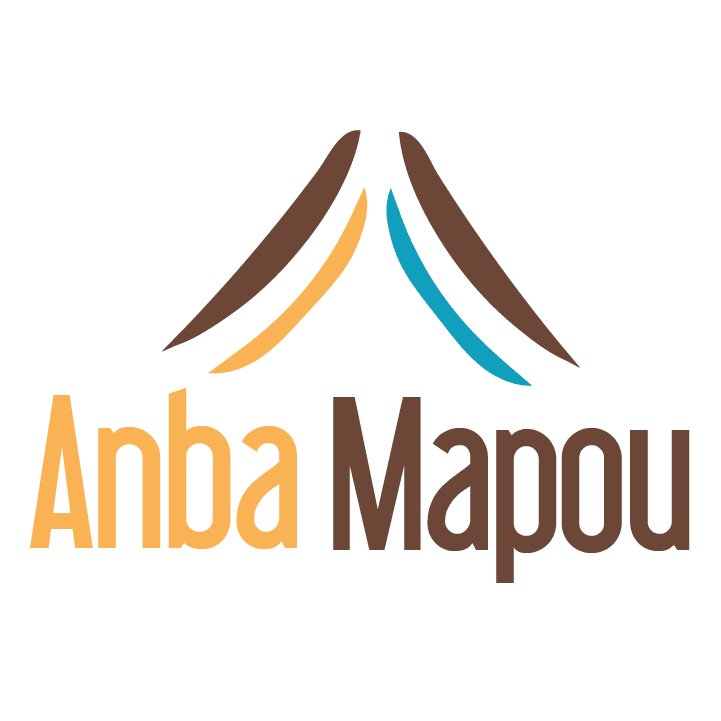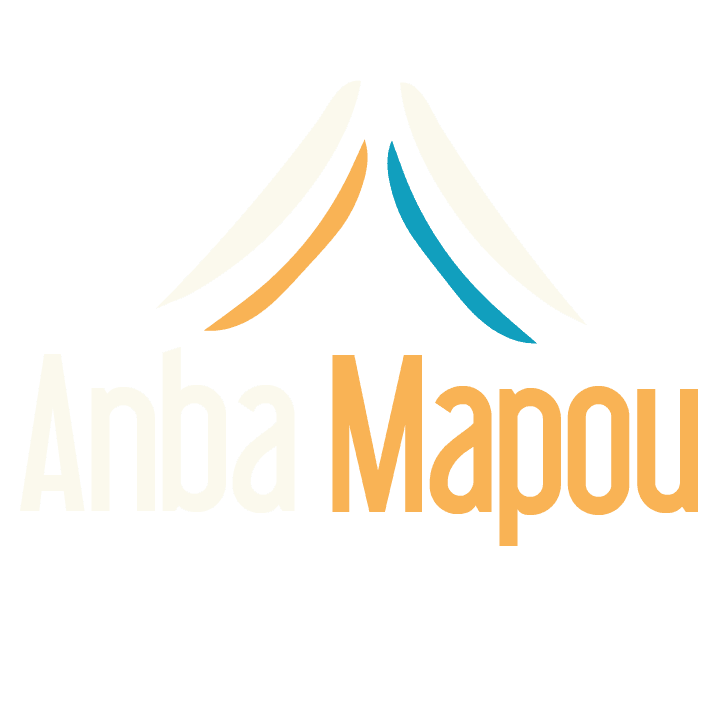L’ancien président américain Donald Trump a, durant son mandat, pris des positions controversées sur Haïti et les Haïtiens, marquées par des déclarations perçues comme dégradantes et des politiques d’immigration restrictives. À la différence de nombreux autres politiciens, il n’a jamais hésité à exprimer ouvertement ses opinions, même si elles sont parfois choquantes. Alors que le gouvernement américain actuel investit des milliards de dollars pour soutenir Israël et l’Ukraine, Haïti reste dans l’ombre, sans une aide significative pour lutter contre l’insécurité qui ravage le pays.
Des déclarations dénigrantes, mais sans hypocrisie
En janvier 2018, Trump a suscité l’indignation lorsqu’il a qualifié Haïti et certains autres pays de « pays de merde » lors d’une réunion sur l’immigration. Ces mots, choquants et dégradants, ont été condamnés à l’échelle internationale et ont profondément offensé les Haïtiens. Cependant, à travers ces déclarations, Trump a clairement exposé sa vision de l’immigration et sa perception des relations entre les États-Unis et les pays en développement, sans faux-semblants ni langue de bois.
Contrairement à de nombreux politiciens qui font souvent des promesses creuses en matière d’aide internationale, Trump a ouvertement déclaré ses priorités, même si cela allait à l’encontre des attentes de pays comme Haïti. Pour Trump, l’aide humanitaire ne devait pas être une obligation des États-Unis, et son approche était d’abord et avant tout tournée vers les intérêts directs de son pays. Bien que déplorable, cette approche a le mérite d’être claire et sans hypocrisie, ce qui en fait un ennemi authentique pour ceux qui espéraient un soutien américain pour Haïti.
Une politique d’immigration sévère envers les Haïtiens
Sous l’administration Trump, la politique d’immigration a été renforcée, affectant de manière significative les Haïtiens vivant aux États-Unis. En 2017, Trump a cherché à mettre fin au Temporary Protected Status (TPS) pour environ 59 000 Haïtiens, les menaçant ainsi d’expulsion. Le TPS avait initialement été accordé après le tremblement de terre de 2010, permettant aux Haïtiens de rester temporairement aux États-Unis. En tentant d’y mettre fin, Trump a démontré sa vision stricte de l’immigration, préférant des politiques restrictives pour réduire le nombre d’immigrants. Dans ses discours, Trump a souvent associé l’immigration à une menace pour l’économie et la sécurité des États-Unis, et il a fait peu de cas des raisons humanitaires pour justifier la présence des Haïtiens aux États-Unis. À l’inverse de politiciens qui pourraient prolonger le TPS pour apaiser les communautés, Trump a toujours affirmé sa volonté de prioriser les Américains. Une position radicale, mais qui n’a jamais laissé place à l’ambiguïté.
L’élite corrompue haïtienne dans le viseur de Trump
Un autre aspect qui distingue Trump est son mépris pour l’élite corrompue haïtienne. Contrairement à certains politiciens américains qui entretiennent des relations ambiguës avec cette élite, Trump a exprimé sa désapprobation envers la corruption et la mauvaise gouvernance en Haïti. À ses yeux, l’aide américaine ne devait pas être détournée par des dirigeants corrompus. En 2020, il a déclaré : « Nous n’allons pas continuer à envoyer de l’argent à des pays où il n’y a aucun retour sur investissement pour le peuple américain. »
Cette position a suscité des critiques, mais elle a aussi rappelé aux Haïtiens que l’avenir de leur pays ne pouvait pas dépendre de l’aide américaine. En refusant de tolérer la corruption, Trump a indirectement mis les dirigeants haïtiens face à leurs responsabilités et a envoyé un message fort aux Haïtiens : il est temps de prendre en main leur propre destin.
L’ombre de l’insécurité et l’absence d’aide concrète
Haïti fait face à une insécurité galopante, exacerbée par la prolifération des gangs qui contrôlent de vastes régions du pays. Pourtant, malgré cette situation alarmante, l’aide américaine n’a pas été suffisante pour renforcer les institutions haïtiennes et restaurer l’ordre. Sous l’administration Biden, les États-Unis ont certes exprimé leur inquiétude, mais les fonds alloués à Haïti restent dérisoires par rapport aux montants massifs destinés à l’Ukraine et à Israël. En 2023, les États-Unis ont promis plus de 60 milliards de dollars en aide militaire et humanitaire à l’Ukraine et des milliards de dollars supplémentaires pour soutenir Israël dans le conflit au Moyen-Orient. En comparaison, Haïti n’a reçu qu’une infime partie de cette aide, principalement sous forme d’assistance humanitaire ponctuelle. L’administration Trump, quant à elle, n’a jamais caché que la priorité de l’aide américaine serait orientée vers les intérêts stratégiques et sécuritaires des États-Unis, et non vers des nations considérées comme « faibles » ou « instables ». Face à cette réalité, les Haïtiens sont confrontés à la nécessité d’apprendre à résoudre leurs propres problèmes de sécurité sans attendre un soutien massif de l’étranger.
Une prise de conscience nécessaire pour l’avenir
L’approche de Trump envers Haïti, bien qu’impitoyable, pourrait amener les Haïtiens à une prise de conscience salutaire. La politique d’indifférence affichée par Trump et le faible soutien de l’administration Biden montrent que les États-Unis ne sont pas prêts à investir significativement dans la sécurité et la stabilité d’Haïti. Cela devrait pousser les leaders haïtiens et la population à repenser leurs attentes et à envisager des solutions autonomes pour rétablir la sécurité et l’ordre.
Au lieu de compter sur des aides temporaires, Haïti doit renforcer ses propres institutions et prendre des mesures pour combattre l’insécurité de manière indépendante. La dépendance excessive envers l’aide étrangère a affaibli les structures nationales et maintenu le pays dans une position de vulnérabilité face aux crises politiques et économiques.
un ennemi authentique, mais un défi pour Haïti
Donald Trump est indéniablement perçu comme un ennemi par une grande partie des Haïtiens. Ses déclarations brutales, ses politiques d’immigration strictes et son refus de tolérer l’élite corrompue haïtienne ont renforcé cette perception. Mais paradoxalement, cette inimitié pourrait constituer une opportunité pour Haïti de se redéfinir.
En rejetant les illusions de promesses d’aide internationale, Trump a indirectement rappelé aux Haïtiens qu’ils doivent compter sur eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes. Avec un avenir incertain et une crise sécuritaire qui persiste, Haïti doit maintenant envisager de nouvelles stratégies pour se libérer de la dépendance envers l’aide étrangère et construire une nation plus forte et plus autonome.
L’ennemi sincère qu’est Trump pour Haïti n’offre peut-être pas de solutions miraculeuses, mais il met en lumière la nécessité pour les Haïtiens de prendre en main leur destin et de surmonter les défis sans attendre d’intervention extérieure.